Commémoration du 50e anniversaire de la mort de Mouloud Feraoun (dossier)

Dans ce dossier, une lecture de son roman posthume "La cité des roses" et un entretien avec Mehenni Akbal, universitaire, auteur de deux essais sur l’œuvre romanesque de l'écrivain assassiné le 15 mars 1962 par l'OAS à Alger
La Cité des Roses de Mouloud Feraoun ou les conquêtes brouillées
La Cité des roses, roman posthume de Mouloud Feraoun est sorti aux éditions Yamcom en 2007. Il est resté à l’état de manuscrit depuis décembre 1958. Dans ce roman, l’idylle amoureuse de son personnage directeur d’école avec Françoise, institutrice française, livre un corps à corps entre les protagonistes et les dernières heures de l’Algérie française.
La trame narrative du roman met en scène deux personnages principaux : l’auteur narrateur, instituteur, fils du bled, contraint à quitter son école de montagne pour la capitale, espérant ainsi échapper aux pressions et sévices de l’armée française. Il est nommé dans une école de la capitale près de laquelle se trouve un bidonville appelé pompeusement La cité des Roses. Il y arrive en 1957 après avoir été arrêté et torturé par les soldats français. Dans le même temps, une française de souche, Françoise ( et son mari), venue de sa Bretagne natale, est nommée éducatrice dans cette école de La cité des Roses. Ce nom, poétique, la fait rêver et accroît ses bonnes intentions de servir l’Education, euphorique qu’elle est d’être dans cette école où délivrer l’instruction relève du miracle. Bien que mariés tous les deux, leur relation dépasse vite les rapports professionnels. Ils se vouent une passion où se mêlent leur amour du métier et leur amour réciproque tout court, bien que restés dans les limites de la bienséance. Cette passion amoureuse est donnée à lire par touches suggestives : des propos presque anodins, étouffés, embués de non dits et de puérilité propre à l’idée qu’ils se font de l’éthique et de la retenue qu’impose le cadre dans lequel évolue leur idylle : l’école, la classe, le bureau, la cour de récréation, parmi les élèves mis en second plan. Est-ce pour autant un simple roman d’amour contrevenant aux règles sociales? C’est bien là une thématique osée d’un Feraoun qui, dans ses précédents romans – et le parallèle ne peut être établi ici avec La terre et le sang où est présente Marie qui joue un autre rôle dans le contexte de la première émigration kabyle en France – n’a jamais développé de telles relations dans ses personnages ! Il l’eût été si ce n’était le contexte politique dans lequel cette relation secrète évolue entre un instituteur indigène venue de la montagne (de l’Algérie profonde) et Françoise venue, elle aussi de la France profonde, partageant tous les deux un même idéal, pétris par les valeurs républicaines transmises par l’école, le savoir.
Les Fouroulou du bidonville
Cet amour peut-il seulement s’exprimer alors que la guerre d’Algérie est dans sa phase cruciale dans les années 1957 / 1958, deux dates qui constituent le cadre historique du roman qui est construit sur la chronologie. La première partie qui donne son titre au roman La cité des Roses comprend deux chapitres : L’instituteur et Françoise, un chapitre narratif à souhait dans lequel le narrateur raconte sa fuite du bled, explique les raisons qui l’ont poussé à quitter son école pour rejoindre la capitale. Le récit est simple et rappelle, par bien des aspects, l’écriture du Fils du pauvre. A son arrivée sur les lieux de sa nouvelle école, à Alger, ce qu’il voit n’est pas fait pour éteindre ses craintes qu’il pensait avoir laissées derrière lui : "Non, ce que voyait l’instituteur, c’était un affreux bidonville où l’on devinait le grouillement d’un peuple misérable et hostile qui se drapait dans ses bâches, ses roseaux, ses vieilles planches et ses tôles rouillées comme dans un manteau d’Arlequin et menaçait de ses ordures pour se soustraire à toute curiosité déplacée, à toute sympathie hypocrite. Cette protubérance insolente, accolée aux confins sud du territoire de la commune, se dissimulait aux flancs d’une crête boisée qui domine la baie d’Alger…" Jouant sur ce contraste, le narrateur semble préparer le lecteur à un autre contraste, politique celui-là : "A l’orée du bois, il, existait un centre éducatif pour les enfants du bidonville, lequel sans arrière pensée s’appelait Cité des Roses" Se peut-il que l’instruction puisse être donnée dans un tel environnement et, de surcroît, dans un contexte de domination coloniale dont la preuve n’est autre que ce bidonville des autochtones ; cette école "française" qui veut s’ouvrir aux enfants du taudis ; un instituteur indigène qui doit tout à la France coloniale qu’il doit servir, sinon…
Le narrateur parle de lui, cette fois, à la troisième personne "L’instituteur n’était pas un traître, mais un hybride. Personne n’en voulait plus, il était bon pour le couteau, la mitraillette ou tout au moins la prison. Lui, brièvement, avait choisi la fuite. Il s’en alla sous les huées. Avant de le laisser sortir, les soldats fouillèrent de fond en comble ses bagages et lui prirent quelques livres…" Ni le moral de cet instit, ni l’environnement social de son nouveau poste d’enseignant, encore mois l’année de son arrivée à Alger ne prédisposent à cette histoire d’amour. Sans compter ses lourdes responsabilités familiales ! Il est alors légitime de ne pas prendre à la lettre cette relation avec Françoise ! Et si elle n’était qu’un subterfuge pour illustrer une autre relation, plus prosaïque, L’Algérie et La France à travers un lieu fusionnel que Mouloud Feraoun connaît bien : L’Ecole qui n’est pas à l’abri du conflit : "Chaque jour, la guerre s’infiltrait à l’intérieur de l’école comme une encre rouge et bouseuse dans laquelle il fallait patauger constamment."
La chronologie dément l’idylle
La rencontre est le titre de la deuxième et dernière partie du roman La Cité des Roses. Cette partie est chronologique. Elle est écrite sous la forme d’un journal intime - technique familière à Feraoun - tenu du 12 juillet 1958 jusqu’au 2 janvier 1959, durant les périodes de vacances scolaires (Les 12 et 17 juillet, les 5, 14 et 23 août, un jour de rentrée le 25 septembre et lors du réveillon le 31 décembre 1958 et le lendemain de la nouvelle année, le 2 janvier 1959). La partie épilogue ( écrite une année après l’achèvement du roman) ne comprend qu’une date, un autre réveillon le 31 décembre 1960). Des dates qui échappent au rythme de la vie scolaire !
L’apparition de Françoise dans cette deuxième partie se fait par une lettre tant attendue du narrateur. Le lecteur est ainsi informé qu’elle a quitté l’instit définitivement et le récit s’amorce par un flash-back progressif, un procédé nouveau dans l’écriture de Feraoun : "Ainsi, Françoise s’est décidée à écrire ! Voilà douze jours qu’elle m’a quitté définitivement et je savais qu’elle allait d’abord prendre de longues vacances en métropole avant de rejoindre, le 1er octobre, son nouveau poste, auprès de son mari cette fois. Quoi de plus normal qu’une jeune femme s’embarquant début juillet pour passer trois mois en France, au milieu des siens, dans un petit village de Bretagne ?…" Ce qu’elle lui écrit ? Pas de mots d’amour. Une simple phrase, dans les canons d’une correspondance aux propos insipides mais chargés de sous-entendus contrastés. Un télégramme sans information. Une impression. Une nostalgie : "Mon ami. Ciel maussade. Votre soleil me manque. Pensées affectueuses. Païen." De ce dernier mot, le narrateur s’explique : « Voilà. Païen est le pseudonyme que je lui ai proposé un jour pour signer notre histoire. Un pseudonyme commun puisque l’histoire était commune…"
Comment alors comprendre le paradoxe apparemment météorologique entre "Ciel maussade" et "Votre soleil" si ce n’est déjà dans l’ordre de la sémantique entre deux climats culturels opposés. L’expression "Mon ami" est teintée de distanciation, d’une familiarité royale.
Françoise n’est pas Marie de La terre et la sang
Comment alors va évoluer Françoise dans cette école et quels sont les ressorts de cette idylle ? Le narrateur reste évasif sur ce point. Qu’est-ce qui l’attire en elle? Le physique? Il n’y a aucune description de cet ordre ? Son dévouement à l’école, à la pratique éducative ? Peut-être. Elle ne voit pas de la même façon la réalité du bidonville où vivent des centaines de Fouroulou ; l’instit le sent et le vit dans ses fibres. Il est des leurs et il en est sorti. Le narrateur insiste beaucoup sur le regard de Françoise, sa tenue scolaire : le port du tablier, le bout de craie entre ses doigts et son éloquence. Parfois, son regard. Sont-ce là des preuves d’amour au sens trivial du terme? La féminité de Françoise est ignorée. Jusqu’aux échanges fugaces, à peine volés au milieu du tumulte des élèves et des regards indiscrets des collègues. Ils ne se touchent pas. Ils se croisent mais ne se rencontrent pas. Ils se serrent virilement" la main et c’est à peine si leurs doigts s’effleurent. N’est-elle qu’un être virtuel? L’objet d’une passion symbolique, un prétexte à un autre rapprochement douloureux? Une confession à deux voix sans faire pour autant un duo, l’Algérie et la France (le prénom de Françoise est alors tout proche de France, de Française et de ce qu’elle symbolise comme culture et civilisation).
En tout cas, le narrateur sème la confusion sur l’existence réelle de Françoise : "Je ne voulais pas qu’on prenne au pied de la lettre cette discussion avec Françoise. Peut-être n’eut-elle jamais lieu, véritablement (…) Ce qui nous importait à l’un et à l’autre était de nous retrouver à chaque instant côte à côte et de laisser nos cœurs s’égarer ensemble, secrètement loin de nos propos graves ou futiles." Le narrateur se fait encore plus déroutant en écrivant quelques lignes plus loin : "Aujourd’hui, seul, dans mon bureau où, dès le début des vacances, j’essaie de la recréer et de l’enfermer à l’intérieur de ce cahier, entouré de mes bouquins et n’ayant que ses pauvres souvenirs, détachés d’elle comme par mégarde : les cheveux, le bout de carie, la petite blouse, dois-je avouer qu’elle devient de plus en plus insaisissable, que parfois il m’arrive de broder, de mêler des bouts de scènes, de trahir l’ordre chronologique des faits et des paroles, en somme d’écrire un roman…" Ecrire le roman qu’il a promis à Françoise. Est-ce cela cette passion ? Une écriture qui tente une fusion pulsionnelle, dangereuse (les deux amants virtuels sont mariés, ayant chacun des attaches sociales, culturelles, généalogiques) et ils ne comptent pas bouleverser cet ordre. Ils gardent leur amour au secret et ont même peur d’être pris au dépourvu.
C’est que, à aucun moment de cette relation qui est contenue par chacun des partenaires, le lecteur n’est emporté comme dans des histoires de roman d’amour classique. Les pages décrivant cette relation sont ardues à lire et le lecteur peine à suivre son évolution et surtout son aboutissement. Est-ce l’environnement scolaire ou le contexte politique qui la réprime ? Le lecteur a l’impression que le narrateur se joue de lui. C’est au moment où il l’entraîne dans un corps à corps amoureux qu’il se retrouve dans un corps à corps politique. L’année 1958 n’est pas un cadre historique banal, mais hautement significative du point de vue politique. Et cette pseudo-relation amoureuse évolue dans ce cadre politique. Au point où les éléments subjectifs (de cette relation interdite) et les données politiques se confondent, s’entrecroisent et sont parfois mis dans un rapport en péril car Françoise appartient aux paras qui, sous la plume épistolaire du narrateur appartient, écrit-il aux "hommes de ta race" : "Deux jours déjà, depuis de coup de téléphone ! Demain, 28 septembre, Référendum. La campagne pour le "oui" tonitruante et sûre d’elle-même a réduit les musulmans au silence (…) Non, ma chérie, je n’ai pas rêvé. Hier et avant hier mon sommeil fut troublé mais non par ton image. IL le sera aussi cette nuit. Des bureaux de vote sont installés à la cité. A chaque instant, je suis sollicité par les fonctionnaires de la mairie. Monsieur le directeur par-ci, monsieur le directeur par-là. Aujourd’hui, on m’envoie les paras pour perquisitionner. Ils ont ouvert les placards, fouillé les poêles, les casiers, les coins et les recoins. Cela a duré deux heures. Puis on m’a demandé toutes les clés du centre qui est donc occupé jusqu’à demain soir. J’ai pu remarquer que l’on s’adressait plus souvent à Nénette ( la concierge) qu’à moi-même, qu’elle inspirait plus d’estime que moi (…) Je crois que tu vas me sauver de ce vain mépris qu’affichent malgré eux les hommes de ta race…"
Une petite histoire d’amour "mixte" face aux dernières heures de l'Algérie française
Tout y est dit. Le lecteur comprend la confiance que place le narrateur en Françoise. Dans le même temps, il lui avoue que ce n’est pas elle qui l’occupe et le préoccupe. Mais son pays. L’objet de pression dont il est l’objet de la part des paras (encore eux !) Cet aveu est de taille ; il va conférer une autre tournure au roman. La relation entre l’instit et Françoise évolue en même temps que s’envenime la situation politique. Alors que l’instit se dirige vers la maison de Françoise, il est témoin d’un attentat « terroriste » près de chez elle. Malgré l’horreur, il continue son chemin et sonne à la porte de Françoise le 2 janvier 1959 et il lui tient des propos enflammés : "Ton corps, ta bouche, tes yeux, tout. Il le faut, Françoise. Je te le demande, c’est cela ?" Et, elle de répondre au conditionnel : "Oui, c’est cela. Moi aussi, je voudrais être à toi, toute. Ce serait bien, je crois…". Françoise a quitté l’Algérie. Définitivement.
C’est autre Feraoun qui se révèle dans ce roman. Proche du Journal, l’écrivain fait montre d’une écriture engagée ; il y exprime sans ambages ses prises de position politiques en faveur de l’indépendance de son pays en soulignant avec force de détails, dans le discours romanesque, les vaines promesses du "miracle algérien" comme du "miracle" de cet amour "mixte" voué à l’échec malgré les atomes crochus à tous les niveaux culturels qui eussent permis le rapprochement. Au terme du récit, Françoise lui offre sa bouche. Mais l’embrasse-t-il ? Le narrateur le suggère, sans plus.
Le parjure de l’Ecole
Sur le plan purement esthétique, Mouloud Feraoun fait évoluer ses personnages dans l’enceinte de l’école de laquelle ils ne sortent pas. Par contre, la guerre qui y entre avec les paras. Des quatre personnages – l’instituteur, Françoise, M.G et le directeur qui finira pas partir (il sera remplacé par l’instit !), seule Françoise a un nom propre. Le "héros" possède deux énonciations : le "je" et le "il" et s’adresse à Françoise de vive voix ou par le truchement de "carnets rouges". Bien que réunis dans le seul but d’enseigner, ils sont tiraillés. L’instit a fui la petite école de montagne ; Françoise a quitté sa Bretagne au "ciel maussade" ; M.G est un pied noir natif d’Algérie et le directeur ne jouant qu’un rôle effacé dans les tensions qui agitent le trio : l’indigène, la française et le pied-noir, représentatifs du contexte socioculturel de l’Algérie de cette période. Françoise attend de l’instit une déclaration d’amour et subit les attaques de M.G qu’elle trouve pourtant assez séducteur.
Dans ce microcosme scolaire, la cour de récréation et le bureau du directeur, le lecteur devient le spectateur d’une pièce de théâtre où tous les ingrédients du problème algérien sont réunis. Dans une atmosphère d’angoisse, de heurts, de tiraillements. Ce n’est qu’aux dernières pages du roman que l’instit sort de l’école pour rejoindre Françoise chez elle, hors du cadre scolaire. Il assiste, chemin faisant à un attentat « terroriste » et, curieusement, sa relation avec Françoise devient quelque peu charnelle.
L’école, dans Le Fils du pauvre, est un espace conquis de haute lutte ; en revanche, ici, dans La Cité des roses, cette même école devient une scène théâtrale où ni les élèves, ni l’instruction, encore moins le savoir ne sont mis au premier plan. Le devenir politique de l’Algérie en cette année du référendum ne concède aucune place à la pédagogie. C’est là que Feraoun a précisément changé dans le traitement romanesque de l’école qui n’est en fait qu’un décor devant les réalités sordides du bidonville et face aux leurres du "miracle algérien".
L’originalité de ce roman, du point de vue esthétique est qu’il est écrit sur deux tons qui, à mesure de leur évolution, se neutralisent : le prétexte d’une idylle amoureuse pour, par son truchement, exposer et affirmer des idées et des engagements politiques. Une petite histoire d’amour qui se superpose à la grande Histoire politique du pays.
Rachid Mokhtari
Entretien
Mehenni Akbal : "J’ai donné à lire des lettres inédites de Feraoun"
Mehenni Akbal est maître de conférences à l'université d'Alger. Il a publié deux essais consacrés à l'oeuvre romanesque de Mouloud Feraoun
Vous avez consacré deux essais originaux sur l’œuvre romanesque de Mouloud Feraoun (Les Idées médiologiques chez Mouloud Feraoun, ENAG-Dahlab, 2001, et Mouloud Feraoun et l’éthique du journalisme, Editions El-Amel, 2007) et publié récemment ses correspondances jusque-là inédites avec le journaliste Maurice Monnoyer qui a interviewé les fondateurs de la littérature algérienne des années 1950. Pourquoi cet intérêt à cet écrivain ?
Mehenni Akbal : Merci de relever le caractère original de mes textes. Le Professeur Mahfoud Kaddache, qui a préfacé les deux travaux, a eu le même sentiment. La réponse est simple. Le parcours littéraire et intellectuel de Mouloud Feraoun est digne d’intérêt. Ce n’est pas seulement un écrivain. C’est aussi un penseur, un intellectuel. Il a composé une œuvre d’une extrême richesse où de nombreuses approches y sont applicables. En effet, le philosophe, l’ethnologue, le linguiste, le sociologue, le spécialiste en sciences de l’information et de la communication, le spécialiste en bibliothéconomie, l’historien, etc. peuvent y trouver matière à étude et à réflexion. Etudier ses écrits me paraît logique pour l’universitaire que je suis.
Vos deux essais Les Idées médiologiques chez Mouloud Feraoun et Mouloud Feraoun et l’éthique du journalisme ont-ils pour objectif de révéler un autre Feraoun ayant un rapport étroit avec les stratégies modernes de la communication ?
Ils révèlent bien plus que cela, un Feraoun qui avait une bonne longueur d’avance par rapport à son temps. Ils révèlent un Feraoun visionnaire. En effet, il a sur un ton prophétique touché subrepticement du doigt des questions lancinantes : l’éthique du journalisme, les rapports incestueux entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, les rapports incestueux entre les médias ; des problématiques devenues objets d’étude et de recherche qu’à la fin du siècle dernier.
L’analyse que vous faites de son roman Les Chemins qui montent en décèle un aspect inédit : l’unanimisme autour d’un fait-divers rapporté par la presse locale et qui ouvre le récit en italique. Pourtant Mouloud Feraoun n’était pas journaliste…
Mouloud Feraoun n’était pas un journaliste. Il avait d’ailleurs refusé sèchement plusieurs propositions de collaboration à des journaux. C’était un homme libre. Il aimait sa liberté et il y tenait. Ce qui ne l’a pas empêché de s’intéresser à un fait-divers local pour produire Les Chemins qui montent qui est à classer parmi les chefs-d’œuvre littéraires et artistiques.
Quelles sont vos références théoriques pour un tel travail d’analyse d’un auteur souvent perçu à travers le seul prisme de l’ethnologie ?
Mes références théoriques ? Il y a du beau monde : Henri Atlan, John L. Austin, Jean Baudrillard, Régis Debray, Jacques Derrida, René Descartes, Umberto Eco, René Girard, André Glucksmann, Jack Goody, Bruno Latour, Karl Popper, Thomas S. Kuhn, etc. Mais je n’en fait pas une "religion" ou un mode de pensée. Car, en général, toutes les théories se valent. Une théorie est une démarche qui consiste à concevoir et à percevoir les faits et à organiser leur représentation. Elle sert à découvrir un fait caché. C’est une construction de l’esprit, élaborée sur la base de l’observation d’une réalité. C’est pour cela que toutes les théories sont prisonnières ou otages d’un système de représentation bien précis. Elles sont, de ce fait, réductrices, partielles, provisoires et factuelles. C’est pour cette raison que j’ai eu recours à une sorte de pluralisme paradigmatique. Ce dernier, quand on maîtrise ses attributs, sert à mieux décrire, définir, comprendre, expliquer, représenter un phénomène.
Dans ses correspondances avec le journaliste Maurice Monnoyer, l’un des premiers à interviewer l’écrivain, Les lettres de Feraoun révèlent en lui un homme de culture modeste mais très exigeant dans l’écriture romanesque…
Au risque de vous contredire, Mouloud Feraoun n’est pas du tout un homme de culture modeste. Sa formation, à l’Ecole normale, était loin d’être superficielle. Il était lié d’amitié avec de grands écrivains : Albert Camus, Emmanuel Roblès, Germaine Tillon, etc. Tous ces intellectuels l’ont reconnu comme étant le fondateur de la littérature algérienne d’expression française. Il a beaucoup lu et était un fin connaisseur de la littérature française et universelle. Il a une maîtrise parfaite de ses outils d’analyse. Oui, son écriture est, en effet, romanesque et marquée par son humanité. Son œuvre est vraie. Feraoun a dit vrai.
Comment avez-vous rencontré le journaliste Maurice Monnoyer ?
Ayant lu son livre Journaliste en Algérie ou l’histoire d’une utopie (L’Harmattan, 2001), et appris qu’il avait été l’ami de Mouloud Feraoun, j’ai désiré entrer en contact avec lui. Je lui ai adressé un e-mail : il a accepté de me rencontrer. Je me suis rendu en France, dans le cadre d’un séjour scientifique, en mars 2009, et j’ai eu le privilège de m’entretenir longuement avec lui dans sa Résidence à Montpellier. Il m’a montré les lettres (inédites) que Mouloud Feraoun lui avait adressées. Ainsi est née en moi l’idée d’écrire Maurice Monnoyer-Mouloud Feraoun, histoire d’une amitié relatant l’amitié nouée entre ce journaliste et Mouloud Feraoun.
Vous venez de publier un opus Mohammed Dib, conférencier : Maurice Monnoyer témoigne (Editions El-Amel, 2009). Pourquoi avez-vous privilégié l’expression à la création romanesque ?
Je n’ai pas privilégié l’expression (la conférence) à la création artistique et littéraire. Mais Maurice Monnoyer m’ayant dit que personne ne savait que Mohammed Dib avait fait une conférence sur la faim de certaines populations en Algérie, j’ai pensé qu’il fallait le faire savoir. Je suis honnête en précisant dès la première page que j’ai fait œuvre de documentaliste et non de critique littéraire ou d’historien. Documenté par Maurice Monnoyer, j’ai rendu compte par des textes et des documents peu connus et/ou inédits des premières années d’écrivain de Mohammed Dib dont la célébrité universelle est allée grandissante jusqu’à s’établir définitivement. Cet opus rend compte d’une conférence donnée par Mohammed Dib, sous le titre "Le prolétariat des villes", aux Journées d’études du Secrétariat social d’Alger tenues, à Alger du 27 au 30 mai 1954. Cette conférence, qui est une véritable dénonciation et révélation de la colonisation, a été donnée à l’instigation de Maurice Monnoyer. Il faut préciser que le Secrétariat social d’Alger est l’œuvre de Père Henri Sanson. Né, en 1917, à Seiches-sur-le-Loir, il est issu d’une famille paternelle originaire d’Evreux et d’une famille maternelle musulmane originaire de l’Oranais. Jésuite depuis 1940, il est Algérien en Algérie, Français en France. Il est Docteur ès-lettres et chercheur au CNRS. En marge des enseignements qu’il dispensait à l’Ecole Secondaire Notre-Dame d’Afrique, il rejoint la Maison des œuvres où il retrouve son vieil ami Eloi Laget. Tous deux, avec l’aide de l’abbé Brenklé et, sur les conseils de Joseph Folliet, qu’il avait bien connu à Lyon au 16 de la rue du Plat, de passage à Alger, et en liaison avec le Cardinal Léon Etienne Duval qui les encourageait, fondent le Secrétariat social d’Alger. Agréé en février 1951, il existe encore et, à ce jour. Le Père Sanson en assure la présidence. Réunissant d’éminentes personnalités (avocats, professeurs, agriculteurs, économistes, écrivains,…), le Secrétariat social d’Alger se distinguera par de nombreuses publications à caractère sociologique et par l’invention de nouveaux concepts.
Vous êtes maître de conférences en bibliothéconomie et sciences documentaires à l’université d’Alger. Y a-t-il un lien entre votre spécialité et vos essais sur la littérature algérienne ?
Ce sont des travaux qui n’ont en réalité aucun lien direct avec mes préoccupations théoriques actuelles. Mais la conception de biobibliographies et de dossiers de documents inédits est une des tâches que s’assigne le spécialiste en bibliothéconomie.
R. M.







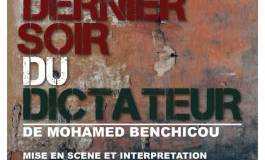


Commentaires (1) | Réagir ?
L' OAS et le FIS même combat le premier a ciblé les personnalités, futurs cadres de l’Algérie indépendante, le second, les intellectuels capables de construire une vraie démocratie.