John Barth : le conteur cynique
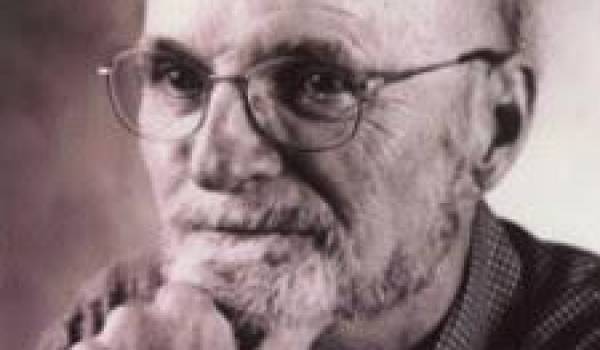
"L’image la plus douce, la plus prometteuse, la mieux adaptée, la plus obsédante que je sache pour un conteur, c’est celle de Schéhérazade. La structure entière des Mille et une nuits me parle directement, intimement, et de plus d’une façon personnelle." John Barth.
John Barth n’a publié, entre 1956 et 1968, que quatre romans. Chacun d’entre eux a été accueilli très favorablement par la majorité des critiques et des lecteurs. On a mentionné, à leurs propos, les noms de Pantagruel, de Candide, de Don Quichotte, de L’étranger… Ces rapprochements sont éminemment arbitraires mais le seul fait qu’on ait pu les proposer suggère une œuvre intéressante et originale.
Cependant, il est également juste de mentionner que John Barth ne rallie pas le jugement de tous et que son dernier roman a été estimé par certains de prétentieux, de pédant, d’ennuyeux et même d’illisible. Lui-même laisse entendre que ses deux premiers romans ne sont pas exempts de naïveté, le troisième et le quatrième d’extravagance. Voilà donc un auteur discuté, dont la cuirasse n’est peut-être pas sans défaut, et qui mérite d’être examiné d’aussi près que possible.
L’opéra flottant est le premier roman de John Barth. Le livre a pour cadre cette région de la côte Est du Maryland, autour de la baie de la Chesapeake, où l’auteur ses années d’enfance et d’adolescence. Dans ce pays de baies et d’estuaires, de golfes et de marais, on trouve de petites villes endormies — telles Cambridge, la ville natale du romancier et le cadre de son premier roman — peuplées de pêcheurs de crabes, de chasseurs de canards sauvages, de dragueurs d’huîtres et des petites gens généralement assez conservateurs.
L’opéra flottant est un récit raconté à la première personne par Todd Andrews, un avocat de Cambridge, un grand bel homme célibataire de cinquante-quatre ans, considéré par ses voisins comme quelque peu excentrique. Le narrateur essaie de reconstituer une journée de sa propre vie, celle du 23 juin 1937. Cette journée a été d’une importance capitale pour lui puisque, pendant ces vingt-quatre heures, il a voulu se suicider et qu’il a, finalement, changé d’avis.
"Etre ou ne pas être ?" Todd s’est posé la fameuse question d’Hamlet. Son père, avant lui, a réfléchi sur le suicide et y avait répondu affirmativement : Todd l’avait trouvé un jour pendu, fort proprement, dans sa cave, à la suite d’un désastre financier provoqué par la Grande Dépression. L’éducation de Todd n’a pas contribué à lui donner l’amour de la vie. Orphelin de mère de très bonne heure, Todd a été sevré d’affection maternelle. Il a, pour ainsi dire, jamais pu communiquer avec son père.
Il s’est engagé à dix ans et a connu, dans l’Argonne, la peur de la mort. Blessé d’un coup de baïonnette, il a tué un soldat allemand et n’a jamais pu oublier cet atroce épisode. En revenant de France où il a combattu, il a poursuivi ses études à l’université. Il a beaucoup lu mais aussi beaucoup bu. Et il a mené une vie parfaitement déréglée. Il a, par la suite, adopté une série de "masques" qui lui ont permis de faire illusion en même temps qu’il se leurrait lui-même. Adoptant une morale de l’indifférence, il offre, en cette période de sa vie, le "masque" d’un aimable cynique. D’autre part, sa santé n’a jamais été bonne : il a le cœur fragile, souffre chroniquement de la prostate et est de moins en moins capable d’avoir une vie sexuelle satisfaisante. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il soit devenu désespéré, de ce désespoir qui "pourrait mener les hommes aux temples, aux églises, aux messies, vers n’importe quelle béquille qui se trouve à proximité".
La conclusion logique de sa réflexion sera, non pas la foi, mais le suicide, parce que rien, aucun absolu, ne le retient sur cette terre. Cependant, après avoir ouvert le gaz et avoir été sauvé accidentellement, après avoir été troublé par l’expression d’inquiétude de la mère d’une fillette malade, il a refusé de mourir. Il reste persuadé qu’il n’a aucune raison de vivre mais décide qu’il n’en a pas non plus de mourir. Il n’y a pas de valeurs absolues mais il y en a peut-être de relatives. Et Todd ne veut pas mourir avant d’avoir essayé de comprendre un peu, de démêler l’écheveau de sa vie.
Les personnages secondaires du roman ne sont pas dépourvus d’intérêt. Harrison et John Mack — le meilleur ami et la maîtresse de Todd — forment un couple bien curieux. Ce sont des instables qui ne sont pas sûrs d’eux-mêmes et qui cherchent à se rassurer de bien étrange façon : en faisant ménage à trois avec Todd. Un beau jour cependant, ils décident de partir pour l’Italie, sans Todd, leur santé morale et leur équilibre fondamental enfin retrouvés.
Fort bien campés également les deux vieillards qui habitent le même hôtel que Todd. Le premier, M. Haecker, est un ancien directeur d’école qui cite Cicéron ("Si un dieu m’accordait de revenir en enfance, de pleurer de nouveau dans un berceau, je refuserais fermement"). L’autre, le capitaine Osborn, est un ancien pêcheur et dragueur d’huîtres qui souffre d’une sinusite aiguë et, de plus, est devenu arthritique et frappe tous les matins sur sa jambe droite pour la réveiller et la mettre en route. Haecker et Osborn représentent deux attitudes différentes face au problème central du livre. Tandis que le premier conclura sa vie par un suicide, le second attendra la mort en lançant des jurons, en soignant sa sinusite à l’aide d’un excellent whisky et son moral en écoutant, pendant ses périodes d’insomnie, le couple d’amoureux qui occupe la chambre d’à côté.
En conclusion, le premier roman de John Barth est une histoire habilement contée, un roman extrêmement bien écrit, vivant, qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière ligne.
Fin de parcours offre quelques points communs avec l’ouvrage précédent. L’action se passe toujours dans une petite ville du Maryland. Le récit est là aussi raconté à la première personne et là aussi, le narrateur est l’amant de la femme de son meilleur ami. Ce dernier aspect du roman, relativement secondaire dans L’opéra flottant est au centre de l’intrigue de La fin de la route. En apparence, rien de plus simple que le canevas du roman : Jack Horner, un jeune professeur d’anglais récemment arrivé sur le campus, est invité à diner par son collègue Joe Morgan. Il devient grand ami du couple, fait du cheval avec Renée, écoute ses confidences, la prend comme maitresse sans amour de part et d’autre. Renée, enceinte, refuse d’avoir un enfant de Jack, se fait avorter et meurt. L’histoire est plus nuancée que celle d’un banal adultère. L’auteur nous présente trois personnages extrêmement complexes et l’action est constituée par les réactions réciproques de ces trois tempéraments rapprochés par un destin tragiquement ironique.
Jack est un malade. Il souffre de dépression et de paralysie de la volonté qui non seulement l’empêche de choisir mais le prive de toute capacité de mouvement pendant une période prolongée. Il se fait soigner par le "Docteur", un médecin noir dont nous ignorons le nom et qui a essayé de le traiter par divers moyens dont l’un consiste à lui faire apprendre par cœur des faits tirés de la thérapie de l’information ou à lui faire enseigner des choses précises telles que la grammaire ou de le plonger dans la lecture de Sartre ("Exister, c’est choisir . Si vous ne choisissez pas, vous n’existez pas. Tout ce que nous faisons doit être orienté vers le choix et l’action… Pourquoi vous ne liriez pas Sartre ? Cela vous maintiendra en mouvement jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convienne mieux…")
Comme Todd Andrews, Jack Horner est une sorte d’étranger qui ne croit en rien et considère toutes comme également indifférentes. La seule raison qui l’empêche de se suicider — comme finalement Todd —, c’est sans doute de rester pour voir la suite du spectacle une fois qu’on a été exposé au premier acte. Jack cite Stendhal qui, dit-il, ajourna son suicide "simplement par curiosité : il voulait voir ce qui allait se passer le lendemain sur la scène politique de son pays."
Joe Morgan est un garçon cultivé et ouvert, qui a pratiqué le scoutisme, et continue de faire du sport. Il a certains principes. Il aime les situations nettes et déteste les "échappatoires". Il croit dans la vertu de l’ "énergie" : "Il faut de l’énergie… pas seulement personnelle mais culturelle… ou vous êtes perdu. L’énergie est ce qui fait la différence entre le pragmatisme américain et l’existentialisme français… Où donc ailleurs qu’en Amérique pourriez-vous avoir un nihilisme joyeux ? Il a établi avec sa femme, en l’épousant, un pacte fondé sur le respect mutuel. Comme il l’explique à Jack "les relations entre époux ne sont certes pas un absolu. Cela ne veut pas dire que je ne leur attache pas une certaine valeur. En fait, j’attache plus de prix à mon mariage avec Renée qu’à n’importe quoi au monde". Comme il croit que tout peut s’expliquer et qu’on doit chercher à tout comprendre, il est troublé par l’infidélité — difficile à imaginer et à expliquer — de sa femme. Décidé à aller jusqu’au bout dans son effort de lucidité, il gardera la plaie ouverte au lieu de panser ses blessures.
Renée est une jeune femme normale, simple, généreuse, qui ne s’était jamais posé de questions avant son mariage. Elle aime son mari et n’a jamais connu un autre homme avant d’avoir connu Jack. Pourquoi trompe-t-elle Joe ? Ce n’est nullement par amour pour Jack. Elle a eu une faiblesse, un bref dérèglement des sens mais elle reste essentiellement fidèle à son mari. Elle lui raconte d’ailleurs son aventure qu’elle regrette totalement. Elle en vient jusqu’à blâmer, mépriser et détester Jack. Tandis que son mari est un homme dans toute l’acception du terme et un être authentique, Jack lui donne l’impression d’être une série de masques successifs et de n’avoir aucune existence par lui-même. Il est "comme quelqu’un dans un rêve, ni fort ni faible". Il n’est "rien". Elle a trompé son mari avec une coquille vide. Ce qui ne l’empêche pas d’être honteuse et désespérée. Et d’en mourir.
Jack est responsable de la tragédie. Et il échappe à toute responsabilité sociale. Alors que Joe perd sa femme et son travail d’enseignant à l’université. Il ne sait même pas ce qu’il devrait ressentir : "tout ce que je trouvais en moi était une certaine angoisse, abstraite et dépourvue de foyer" avec un goût de cendres dans la bouche.
Fin de parcours est comme son prédécesseur, un ouvrage bien ficelé. L’auteur, se servant d’une intrigue éculée, arrive à la rendre non seulement parfaitement vraisemblable, mais originale et captivante.
Le courtier en tabac est le livre que j’ai le plus aimé. Tandis que les deux premiers étaient des romans psychologiques assez ramassés, Le courtier en tabac est un opus de plus de 800 pages et un livre beaucoup plus difficile à classer puisqu’il tient à la fois du roman historique, de l’épopée, du roman picaresque, de la farce, de la satire et de l’allégorie.
Le héros du roman est un certain Ebenezer Cooke, un jeune poète de la fin du XVIIe siècle. Fils d’un commerçant en tabac, il est né et a été élevé en Amérique, dans le Maryland. Il avait "plus d’ambition que de talent et cependant plus de talent que de prudence". A part cela, il était timide et indécis et, à vingt-neuf ans, vierge. Nommé « poète lauréat » du Maryland, il reçoit pour mission d’écrire un poème épique, "la Marylandiade", et part voyager à travers l’Amérique. Cet ingénu est exposé, au cours de ses voyages, à diverses aventures : naufrage, capturés par les pirates, intrigues politiques, rébellion, pris en otage par les indiens… Sa propriété devient une fumerie d’opium, sa sœur jumelle Anna est enlevée par un prince Ahatchwhoop, il rencontre des bandits, des imposteurs, des faux-prêtres, des trafiquants d’esclaves, des prostituées et divers autres personnages pittoresques et peu moraux. A travers l’intrigue, apparaît et réapparaît, sous plusieurs déguisements l’ancien précepteur d’Ebenezer, Henri Berlingham III, qui, en cherchant l’identité de Berlingham I et de Berlingham II, découvre l’étonnant journal secret du fameux capitaine John Smith. Finalement, Ebenezer écrira, non pas "la Marylandiade", mais une amère satire relatant ses déceptions.
Le style de John Barth est comparable au cours d’une rivière tranquille. Dépourvu de hâte, il est marqué par d’innombrables méandres ou digressions qui alourdissent parfois le développement de l’intrigue. Le désordre de cette prose vagabonde et cultivée est fortement étudié. Parfois, on tombe sur des passages tellement fabriqués au point d’en être obscurs. L’auteur, comme ses héros, aime le son des mots anglais. Il joue avec eux, il le dit souvent. L’auteur utilise souvent ses dons d’humoriste. La description des testaments du vieux Mack, "le roi des cornichons" dans L’opéra flottant est particulièrement réussie : "Dans le testament n° 13, l’ensemble des biens de Mack passait à l’Eglise, avec l’espoir que plus la religion organisée deviendrait riche et influente, plus tôt elle serait rejetée par le peuple. M. Mack, dont l’anticléricalisme était plus fort que sa connaissance de l’histoire, croyait que la prédominance de l’église catholique en Europe au Moyen-Âge avait mené à sa destruction par les athées intelligents du XVIIIe siècle." "Le testament n° 6 faisait de Mme Mack la légataire universelle, à condition qu’elle se fût abstenue de goûter du vin champagnisé depuis 1920."
Dans Fin de parcours, le narrateur, à qui on a recommandé les vertus curatives de la lecture de Sartre, s’interroge de la façon suivante : "Comment l’existentialisme pouvait-il aider à décider si on apporterait un repas froid ou si on le prendrait à la cafétéria de l’usine ?"
L’auteur de La croisière du Pokey se moque de divers aspects de la civilisation contemporaine et, comme Rabelais et tant d’autres après Rabelais, des diverses faiblesses humaines : hypocrisies de toutes les nuances, pédantisme, jargons incompréhensibles, spécialisation abusive, freudisme, sexologie, culte de la machine et de l’ordinateur, anti-humanisme, ismes de toutes sortes…
John Barth est un humoriste mais il se défend d’appartenir à la catégorie des humoristes noirs. Ce sont, dit-il, des gens qui dramatisent : "La folie de la société contemporaine, de la guerre moderne, de la vie menacée par les bombes, de "Nous autres, aujourd’hui… " Quant à moi, je dis ô muse, protège-moi, quand je suis assis à mon bureau, de la responsabilité socio-historique et, en dernière analyse, de toute espèce de responsabilité, sauf celle de l’artiste."
Kamel Bencheikh










Commentaires (9) | Réagir ?
merci
merci