Kamel Ben Hameda (écrivain libyen) : "Mes Tripolitaines auraient sans doute participé au soulèvement !"

L'auteur dédie ce livre aux femmes et aux mères qui, une fois par semaine, pendant des années, manifestaient à Benghazi en Libye devant la direction générale de la Sécurité pour réclamer le corps de leurs époux, de leurs enfants disparus cette nuit du 28 au 29 juin 1996, ces dames dont la brûlure du manque a ranimé peu à peu, secrètement, les flammes de la dignité »
La compagnie des Tripolitaines (roman, Ed. Elyzad, Tunisie, 2011) de Kamel Ben Hameda, écrivain libyen vivant aux Pays-Bas, se veut une ode aux femmes, épouses, mères, femmes, qui, malgré les violences multiples dont elles sont victimes, sont pleines de vitalité, se ressourcent dans leur espace de paroles intimes qui échappe à toute soumission. Face à l’ordre mortifère, théologique et idéologique, des mâles, des séquelles de l’histoire et de l’ordre établi du « Père omnipotent », et bien que brimées, battues, violées, interdites d’amour, ces Tripolitaines manifestent un intarissable désir de liberté.
Le garçonnet, Hadachinou, le narrateur témoin de leur vie cachée, est subjugué par leur royaume imprenable. Il refuse le monde terne des hommes auquel il est prétendument destiné par le rite de la circoncision qu’il vit comme une mutilation. Toléré par le monde magique des Tripolitaines, amies ou voisines de sa mère, il s’initie avec bonheur à l’échange, la liberté, la tolérance, la solidarité, la joie, le rire. Pour l’enfant, chacune d’elles est un poème, un hymne à la vie dans une société fermée…
Dans cet entretien qu’il nous livre en exclusivité, Kamel Ben Hameda rend hommage, par le verbe poétique, à la résistance des femmes libyennes, maghrébo-arabes, de tous les pays « où les femmes subissent l’oppression, quelle qu’en soit la forme, elles sont image de toute vie niée et bafouée au nom d’une théologie ou d’une idéologie. »
Vous avez quitté la Libye dont vous avez dénoncé la « sécheresse culturelle ». Ce roman se veut-il une image littéraire de celle-ci ? Un acte de résistance par la mémoire de ces femmes et mères de Benghazi auxquelles vous dédicacez ce roman ?
Kamel Ben Hameda : Un pays où ne se trouvent autorisées que la lecture du Coran et celle du Petit Livre Vert peut par euphémisme et dérision être taxé de quelque sécheresse culturelle, toute autre lecture révélant un esprit de rébellion propre à déstabiliser la société. Opération lessivage des cerveaux caractéristique dans toute dictature. Le temps de ce récit ne se situe évidemment pas sous le régime despotique de Kadhafi mais sous le règne du roi Idris. Comment, depuis un pays où les droits d’expression, de réunion, de manifestation sont reconnus, oserait-on prétendre faire acte de résistance avec ces femmes qui au risque de leur vie manifestaient devant la Direction Générale de la Sécurité à Benghazi pour réclamer les corps de leurs fils, de leurs frères, de leurs époux ? Cette dédicace n’est qu’un hommage à celles qui n’oublièrent pas leur dignité de mères, de sœurs, d’épouses et en appelèrent aux sentiments humains primordiaux ranimant peut-être des étincelles à demi éteintes dans la peur et la soumission acceptées.
Dans votre roman, c’est une Tripoli multi ethnique et confessionnelle (berbère, arabe, juive, afro-américaine qui (re) vit dans à travers la voix des femmes brimées par l’idéologie uniciste de la seule identité arabo-islamique ? Cela est valable pour tous les pays maghrébo-arabes…
Ces femmes sont celles de la Tripoli des années soixante, celles de la Libye d’alors et maintenant, de tous les pays maghrébo-arabes, de tous les pays où les femmes subissent l’oppression, quelle qu’en soit la forme, elles sont image de toute vie niée et bafouée au nom d’une théologie ou d’une idéologie.
Le lecteur découvre, grâce à un garçonnet, Hadachinou, dans la capitale libyenne, Tripoli, des années soixante, un univers intime de générations de femmes dont la parole brise les interdits, les tabous, le dictat des hommes, de la tradition. Hadachinou ne feint-il pas l’innocence pour y avoir accès ?
Hadachinou feint-il, ne feint-il pas ? Ce qui est certain, c’est qu’il n’est toléré dans le cercle des femmes qu’en tant que présence-absence, il n’est admis que par son statut d’enfant, il ne peut être au plus intime de ces femmes que s’il en est oublié, non existant, quels que soient par ailleurs ses émois personnels.
Des portraits saisissants de générations de Tripolitaines à travers lesquels Hadachinou brise l’image idyllique de sa propre mère. Il pénètre ses secrets et découvre en elle une femme brimée comme les autres. Le lien ombilical dont il n’a pas voulu se détacher n’est-il pas rompu au contact de la réalité politique et non plus intimiste qu’il perçoit ?
Femmes brimées, battues, soumises à la volonté du père, du mari, de la tribu, victimes de l’oppression, certes, mais toujours si pleines de vitalité. Il ne s’agit pas pour elles de contester l’ordre du mâle mais de préserver un espace de paroles et de corps libres où elles se puissent ressourcer.
La révolte des Tripolitaines s’exprime dans l’intime, dans leur enfermement même alors que celles qui bravent l’interdit finissent au lupanar de Luna Park ou s’immolent. Comment le garçonnet, témoin de ces tragédies, peut-il encore soutenir son rôle de narrateur impliqué ?
Voir, avoir vu, rapporter le tu de l’histoire officielle : la fiction est comme une autre manière de revisiter l’histoire, de la raconter, de s’en emparer …
Ces voix de femmes sont dans le registre de la plainte, de la complainte et non dans la révolte proprement dite. Est-ce parce qu’elles revendiquent l’amour, la beauté, l’art, la liberté dans leur négation même de leur vie d’épouses, de femmes, d’amantes ?
Elles ne se révoltent pas, revendiquent-elles ? Elles se créent un espace où vivre dans l’échange, la liberté, la tolérance, la solidarité, où trouver joie et chaleur, où rire.
De toutes les Tripolitaines, c’est Nafissa qui a le verbe haut, cru et révolté contre le machisme des hommes alors que les autres subissent leur sort. Ce que voit en cachette le garçonnet ne le rapproche-t-il pas de cette Nafissa qui est la mauvaise conscience de sa propre famille ?
Sans doute ces femmes subissent-elles leur sort mais en apparence seulement, par elles-mêmes elles sont contestation de l’ordre qui les soumet, on pourrait dire, en toute innocence : elles sont la vie face à l’ordre mortifère. Nafissa quant à elle, dans la sagesse du grand âge donne forme et sens à leurs propos, elle analyse et pense le statut de la femme. « La radicalité » de son point de vue peut s’exprimer d’autant plus librement qu’elle occupe dans le cercle une position satellitaire, on tolère sa parole comme on tolère la présence de l’enfant.
Un paradoxe littéraire : Hadachinou est un garçonnet qui décrit ses voyages d’une femme à l’autre à travers des yeux d’adulte. Mais ne feint-il pas l’innocence puisque le récit s’amorce par la circoncision, le rituel qui consacre, en principe, son entrée dans le monde des hommes ?
Tout pouvoir ne peut s’exercer probablement qu’en contrôlant le corps. Le rituel de la circoncision n’est pas vécu par Hadachinou comme passage dans le monde des hommes, mais comme rite barbare parallèle au sacrifice du mouton, mêmes débats, même abandon de la victime devant l’inexorable, même sang qui gicle sous le couteau. Loin d’intégrer l’enfant au monde des hommes, ce cérémonial, vécu comme mutilation, inscrit au plus intime son refus de l’ordre des mâles, de l’ordre des violences et des violations, il se trouve de fait par cette expérience, associé au cercle des femmes, même si la mère cherche à écarter l’intrus devinant en lui le futur petit mâle.
Le monde des hommes est rarement décrit alors qu’il pèse et hante tous les récits des tripolitaines ?
Hadachinou n’est pas dans le monde des hommes, (il refuse même les jeux virils des garçons de son âge, fuit leurs cris, craint leurs quolibets et fait de longs détours pour éviter leurs terrains d’élection) mais il en mesure le pouvoir à l’image de celui du père omnipotent, omniprésent quoique cantonné dans l’isolement au cœur de la maison.
Le style poétique, teinté de nostalgie par l’enfance de Hadachinou n’enjolive-t-il pas ces paroles féminines ?
Peut-être, mais il me semble qu’Hadachinou, captivé, les percevait comme poèmes ambulants ces belles innocentes, ces bavardes impénitentes comme les nommait Nafisssa.
Le « je » de Hadachinou (et son temps d’énonciation, les années 60) ne se superpose-t-il pas au « je » de l’auteur (et à son temps d’énonciation, les années 2000). En 40 ans d’intervalle, qu’est-ce qui a changé. Peut-on oser cette interprétation : Hadachinou n’était-il pas déjà au cœur de la révolution démocratique libyenne ?
On peut s’interroger sur la nature démocratique de la révolte en Libye, processus enclenché dont l’histoire seule nous dira l’issue et, par ailleurs toute révolution assurerait-elle systématiquement la libération des femmes ? Hadachinou est un témoin que fascine l’élan vital de ces femmes malgré toutes les formes d’oppression subies, il se situe, je crois, en dehors de tout contexte politique, un enfant irrécupérable en somme !
Pourquoi la forme du conte qui ouvre et clôt le récit ?
Le conte ressuscite un monde révolu et lui confère une part d’éternité, je ne sais si ce récit, inscrit dans cette parenthèse, peut se teinter des couleurs du conte ; je souhaitais en tout cas rendre hommage à ces femmes et que leur société si chaleureuse au-delà de tout ce qui pouvait les séparer restât sous nos yeux comme en exemple.
La Libye des années 60 à travers ses femmes se lit aujourd’hui dans le contexte des révolutions arabes et du soulèvement armé contre le régime de Kadhafi. N’en établissez-vous pas un lien ?
Animées du même élan que celles et ceux qui sont descendus dans les rues, qui ont pris les places, occupé l’espace public, elles auraient sans doute participé au soulèvement, mais le régime de Kadhafi n’est qu’un des avatars de l’oppression, certes des plus hideux.
Entretien réalisé par Rachid Mokhtari
Précision historique
La Libye des années 1960 que vit l’enfant Hadachinou dans ce récit est celle du roi Sidi Muhammad Idris al-Mahdi al-Sanussi, né le 12 mars 1889 à Jaghboub (Cyrénaïque alors province ottomane) et mort le 25 mai 1983 au Caire (Égypte), a été roi de Libye du 24 décembre 1951 au 1er septembre 1969 sous le nom d'Idris Ier . Reconnu comme émir de Cyrénaïque par le Royaume-Uni en 1946, il est proclamé roi de Libye le 24 décembre 1951 lors de l'accession du pays à l'indépendance. Le 1er septembre 1969, alors qu'il est en traitement médical en Turquie, il est déposé par le jeune capitaine Mouammar Kadhafi et meurt en exil au Caire.
Les récits des Tripolitaines, quant à eux, renvoient à l’occupation de la Libye par l’Italie sous le régime fasciste de Mussolini durant la deuxième guerre mondiale.
Le temps d’énonciation de l’auteur est celui de la Libye des années 2000 sous le pouvoir du président Muammar al-Kadhafi.
Paroles rebelles de femmes libyennes
Écrit dans la tradition des contes berbéro-arabes, ce récit porté par un garçon, Hadachinou, dresse au fil des pages qui s’égrènent, des portraits de femmes de Tripoli des années soixante. Elles se confient hors du puritanisme ambiant, disent leurs bravades, révoltes, revanches, malices et sorcelleries paillardes contre les musellements dont elles sont victimes…Kamel Ben Hameda en offre une peinture d’un monde puritain et paillard à la fois, avec ses coutumes , ses babils, ses « sociétés » masculines et féminines distinctes.
Ruelles plombées de soleil, patios fouettés par les vents de sable du désert, ville qui se refuse à ses rivages marins, c’est dans cette géographie contrastée et bouleversée de la capitale libyenne, Tripoli, que la magie littéraire ouvre les portes closes des demeures féminines, en conte la quotidienneté faite de privations, les solidarités insoupçonnées, les secrets et les confidences chuchotés de tripolitaines dont la voix, le corps, le désir, le rêve gouvernent l’espace physique et symbolique d’une ville morte de l’extérieur régenté par les hommes imbus de religiosité de « mâle dominant », mais si palpitante de vie, de rires, de colères, d’irrédentismes et d’amour derrière les portes closes ou même dans maisons closes.
Ce roman La compagnie des Tripolitaines de Kamel Ben Hameda déborde de tendresse mais aussi de mots aiguisés contre les enfermements des femmes en pays dits musulmans, par le fait même qu’il en « viole » la parole intime. Evoquant son enfance dans un quartier de sa Tripoli natale des années mille neuf cent soixante, l’auteur met en scène un garçon qui, au sortir de son innocence, est immergé dans l’entourage immédiat de sa mère, dans le gynécée des cousines, tantes ou voisines qui s’invitent à l’heure du thé, lors des fêtes religieuses ou païennes, pour épancher leurs douleurs d’épouses maltraitées, partager des moments de libertés intimes durant lesquels elles font sauter les barrières factices, dévoilent leur corps et leurs paroles, se jouent de leurs époux rustres, fêtards et faux dévots.
Ce garçonnet Hadachinou, le narrateur, avec des yeux d’adulte, est le témoin privilégié de cet univers de sensualités brimées, de corps violés et d’amours trahies. Il maintient un précieux lien de vie encore possible entre sa mère dont il est le messager, porteur de victuailles, de nouvelles, d’invitations, et les femmes dont il est devenu le prince charmant, un tantinet espiègle, un futur mâle qu’elle comptent bien domestiquer, d’autant que le quartier vient de fêter sa circoncision. Hadachinou voyage dans un royaume féminin régi par sa mère dont il connaîtra grâce à ses voyages d’une femme à l’autre, la vie secrète, faite de privations, de rêves de jeunesse brimés, encore vivaces en elle, autrement que par cette image d’une mère docile, silencieuse, debout, éternellement affairée derrière ses fourneaux préparant des gâteaux au caramel. Il la surprend, épancher ses douleurs, à sa grande tante, Nafissa, qui ne mâche pas ses mots, fume et boit de la boukhla, se rit des promesses hypocrites des hommes, les met à nu de leur ventre à leur bas-ventre, les défie dans leur territoire, les rues et les marchés, et jure par ses aïeux, qu’elle leur fera payer sa liberté si durement acquise.
Qu’elles s’appellent Fella, et sa petite Tuna, Zohra, Jamila aux fesses rebondies, Khadija, l’hirondelle de la fête à Luna Park, Haja Kimya la sorcière, Filoména l’italienne déprimée, Zaïneb, l’instruite, éveillée à l’amour, qui pour échapper au mariage forcé, s’est immolée par le feu, toutes sont tripolitaines aux origines diverses, arabe, berbère, africaine, italienne mais vivant et partageant toutes la même bravade, les mêmes malices, les mêmes vengeances sourdes, les même révoltes parfois au grand jour contre leur sort de femmes soumises, violentées au quotidien, portant aussi le bât de l’histoire contemporaine d’une Libye méconnue.
Signora Filoména, une Italienne qui y a fait souche sur trois générations, couturière renommée dans le quartier, vit avec la peur au ventre d’être chassée comme une étrangère. Hadachinou entend sa mère Aziza lui dire : « Mais pourquoi vous chasserait-on ? Qui vous veut du mal ? Vous êtes nés ici,, vous êtes Tripolitaines, vous êtes des gens du pays, tu manges tripolitain, tu parles tripolitain, tu rêves tripolitain, ne t’inquiète pas, je suis là… »
Quelles belles paroles réconfortantes, fortes de solidarités. Lorsque sa grande Tante, la sulfureuse Nafissa, revient au pays de sa lointaine Djerba, en Arabie, c’est toute la maison qui vit au rythme de cette Shéhérazade au verbe cru, de son irrédentisme paillard à couper le souffle aux hommes les plus autoritaires de la tribu. Hadachinou en est subjugué. Il boit ses paroles même s’il n’est pas encore en âge d’en comprendre la quintessence : « J’ai passé ma vie à Djerba, c’était la vraie vie ! là-bas, j’ai séduit bien des yeux. Tu verras quand tu seras grand, mon petit Hadachinou ! Mais un jour un beau monsieur a su capter mon cœur et alors j’ai connu le véritable amour : je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne voyais plus que lui devant moi, j’étais envoûtée ! Mais lui ne m’aimait pas, il ne voulait pas de moi. Je fumais déjà et j’allais boire de la boukha ou le laghbi, ce délicieux vin de palme, avec les Juives et les Françaises, le soir sur la plage, les pieds dans la Méditerranée. J’étais désespérée de ses dédains alors, aujourd’hui je respire ; si je m’étais mariée avec lui, j’aurais perdu ma liberté…Depuis, tout le monde m’évite, me méprise ; on dit que je suis une femme facile ; même ta famille, ma famille s’est éloignée de moi, de honte, disent-ils. Je veux retourner à Djerba, ici à Tripoli les gens sont trop durs. Ils n’y comprennent rien à l’amour. »
Zaïnab, l’adolescente, aussi, s’est révoltée au prix de sa vie, pour échapper au mariage forcé après avoir connu les frissons d’un amour interdit. On aurait dit que la canicule était annonciatrice du drame : « C’était un après-midi de soleil sans merci et, comme une punition ou une malédiction, alors que j’approchais dans la torpeur des rues endormies, des cris strièrent le silence ; au loin une silhouette chancelante, hurlante, une torche vive : Zaïneb pour échapper au mariage s’était aspergée de naphte ». Pour Hadachinou, sa mère Aziza dont il a maintes fois entendu les plaintes « personne ne m’aime » s’est bien gradée de lui raconter son mariage : « Plus tard, une autre fois, quand tu seras grand, lui disait-elle, se réfugiant dans l’époque de son enfance au cœur de la tragédie de l’occupation italienne sous Mussolini : « Je peux te parler de mon enfance, du temps de la famine et de la colonisation italienne. Tiens, à ton âge, j'étais déjà apprentie, j’allais au marché de l’artisanat et tu sais ce que je faisais ! Je brodais des tapis. Mon père, lui, il était sandalier et voulait que j’apprenne un métier. Il m’a retirée de l’école italienne le jour où on a réquisitionné tous les enfants pour saluer la venue de Mussolini à Tripoli. Ton grand-père n’a pas pu supporter ça, mais je crois plutôt qu’il avait besoin d’une bonne excuse pour me faire quitter l’école… ».
La femme de la magie, de la foire de Tripoli, la « femme sans visage », ensorcelante, est, parmi toutes, la seule à emmener Hadachinou hors de la réalité et à lui faire goûter le fiel de la séparation, de l’absence, de l’amour maléfice.
La guerre, celle de la colonisation italienne puis la venue des alliés, des troupes américaines notamment, se confond avec l’histoire intime de Fella, d’origine juive qui a connu, elle aussi l’amour avec un soldat américain d’origine africaine dont elle a eu une fille, Tuna qui cherche désespérément l’origine de sa peau noire, si sensuelle, contre laquelle Hadachinou a senti ses premiers émois.
Que de palpitations, de paroles secrètes, de réminiscences gustatives, de tensions affectives, d’élans maternels et charnels pour Hadachinou qui feint l’innocence d’un garçon aveugle aux secrets, aux confidences intimes de ce gynécée qui tantôt prend le ton des Mille et une nuits, tantôt celui d’une Tragédie collective des mille et un malheurs qui ont marqué, par des chemins ardus, la vie de toutes ces Tripolitaines à travers la parole desquelles, c’est une Libye profonde, vraie, authentique, hors de l’image surfaite du « zaïm » et du puritanisme de l’idéologie nationalo- islamiste qui s’exprime ; une Libye poétique qui se conte par le vécu de ses femmes, dans son intimité, ses histoires, son Histoire, dans sa complexité, où s’entrechoquent un puritanisme de pacotille mais si castrateur et un élan de vie irrépressible vers la liberté, les solidarités festives, au-delà des considérations futiles de la morale, de la bienséance et des « qu’en dira-t-on ? »
Sur le plan de sa construction esthétique, ce roman épouse la forme d’un conte matriciel qui ouvre et clôt cette ronde de portraits ensorcelants du royaume maternel de Hadachinou : « Sept filles dans une flûte. La goule tourne et tourne et en mage une » pour finir avec cette amputation fantastique « Sept filles dans une… »
R.M
Bio-express
Kamel Ben Hameda est né en 1954 à Tripoli. Dans les années 70, il quitte un pays dont il dénonce l’oppression insidieuse et la « sécheresse intellectuelle », part en France poursuivre ses études puis s’établit aux Pays-Bas où il vit aujourd’hui. Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie







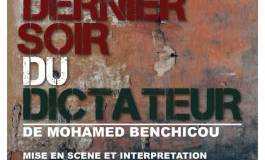


Commentaires (0) | Réagir ?